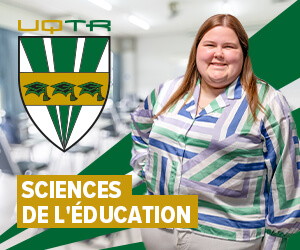Cet article – Courant d’idées – est rédigé par Anderson Araújo-Oliveira, professeur titulaire au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et Geneviève Therriault, professeure titulaire à l’Unité départementale des sciences de l’éducation de Rimouski, à l’Université du Québec à Rimouski.
Soutenir les personnes enseignantes : une nécessité partagée

Geneviève Therriault, professeure titulaire à l’Unité départementale des sciences de l’éducation de Rimouski, à l’Université du Québec à Rimouski.

Anderson Araújo-Oliveira, professeur titulaire au Département des sciences de l’éducation de l’UQTR.
Dans le monde de l’éducation, un consensus émerge : la formation des enseignants ne peut se limiter à leur préparation initiale. En France, en Suisse, en Belgique, au Brésil ou encore au Québec, pour ne prendre que l’exemple de ces cinq systèmes éducatifs analysés dans le cadre du récent ouvrage intitulé Trente ans de politiques de professionnalisation des enseignants : regards internationaux (Marcel et al., 2022), les politiques éducatives ainsi que les chercheuses et chercheurs s’accordent sur une vision commune. La formation des enseignantes et des enseignants doit être polyvalente, intégrée et ancrée dans la pratique professionnelle. Mais elle doit également s’inscrire dans une démarche de formation continue, accompagnant les personnes enseignantes tout au long de leur carrière pour répondre aux transformations constantes des besoins des élèves et des exigences de la société actuelle.
Cette nécessité, bien documentée dans les travaux scientifiques et les rapports institutionnels, trouve son origine dans la complexité croissante du métier d’enseignante et d’enseignant. Les élèves d’aujourd’hui évoluent dans un monde où les informations sont omniprésentes, les technologies en mutation constante, et les défis sociétaux et environnementaux, multiples. Former des citoyennes et des citoyens critiques et engagés exige des personnes enseignantes qu’elles actualisent sans cesse leurs connaissances, mais aussi qu’elles développent des compétences professionnelles ayant un caractère transversal, comme la communication, la flexibilité et la collaboration.
Pourtant, dans de nombreux systèmes éducatifs, une véritable culture de développement professionnel peine à se concrétiser. Bien que des initiatives de formation initiale et continue aient été mises en place dans divers contextes, celles-ci ont bien souvent du mal à s’intégrer de manière durable dans la réalité des écoles primaires et secondaires. Les contraintes organisationnelles, le manque de ressources et l’absence d’une vision claire à long terme freinent couramment l’impact de ces initiatives.
La didactique : un atout pour le développement professionnel
Parmi les nombreuses dimensions à explorer pour enrichir la formation des enseignantes et des enseignants, la recherche en didactique apparaît incontournable. Cette discipline scientifique, qui analyse les « contenus (savoirs, savoir-faire…) en tant [qu’]objets d’enseignement et d’apprentissage » (Reuter, 2010, p. 69), inscrits dans les disciplines scolaires et leur aménagement dans des situations d’enseignement et d’apprentissage (SEA) (Develay, 1995; Lenoir, 2020), occupe une place centrale dans le processus de développement professionnel continu (Mukamurera, 2014).
Pour enseigner efficacement, il ne suffit pas de connaître son sujet. Il faut comprendre les savoirs – compris dans un sens très large – en profondeur : leur origine et leur genèse, leurs cadres épistémologiques, axiologiques et méthodologiques, leur progression dans les programmes scolaires et leur pertinence pour l’apprentissage des élèves. La recherche en didactique aide les personnes enseignantes à s’approprier ces savoirs de manière critique, en tenant compte de leur évolution historique, de leurs implications culturelles et de leur rôle dans la formation des citoyennes et des citoyens de demain.
Une fois ces savoirs maîtrisés, encore faut-il parvenir à les rendre accessibles aux élèves. Concevoir des SEA adaptées, riches, signifiantes, différencier les approches selon les besoins des élèves, recourir à des ressources pédagogiques innovantes, voilà autant de défis auxquels les enseignantes et les enseignants sont confrontés au quotidien. La didactique les accompagne en leur fournissant des approches et des stratégies concrètes afin de construire des SEA efficaces et engageantes. Ces propositions didactiques incluent, par exemple, l’utilisation de récits et l’analyse critique de documents historiques en classe d’histoire ou encore l’intégration de simulations interactives en cours de sciences dans le but de soutenir une démarche d’apprentissage à caractère scientifique.
L’évaluation constitue une étape clé de l’enseignement, mais aussi l’une des plus complexes. Elle ne se limite pas à mesurer les connaissances acquises : elle sert aussi à orienter l’enseignement et à soutenir les élèves dans leurs apprentissages. La recherche en didactique explore des modalités variées pour aider les personnes enseignantes à évaluer les savoirs enseignés, identifier les besoins spécifiques des élèves et offrir des rétroactions constructives. Ces recherches mettent également en avant l’importance des évaluations formatives fréquentes et variées, qui permettent aux élèves de mieux comprendre leurs progrès et aux enseignantes et enseignants d’ajuster leurs pratiques en temps réel.
Des avancées prometteuses
Ces trois axes – compréhension approfondie des savoirs disciplinaires à enseigner, capacité de rendre ces savoirs disciplinaires accessibles aux élèves et l’évaluation des apprentissages des savoirs disciplinaires enseignés – sont au cœur des travaux en didactique. Des études menées un peu partout à travers le monde suggèrent que cette discipline scientifique joue un rôle essentiel pour outiller les personnes enseignantes face à la complexité croissante de leur profession. Cependant, force est de constater que la diffusion des résultats de recherche demeure un défi. Bien que de nombreux travaux aient été publiés dans des revues et ouvrages spécialisés, peu d’initiatives visent à établir des ponts concrets entre ces avancées scientifiques et la pratique enseignante quotidienne. Les enseignants, souvent confrontés à des exigences élevées, à un emploi du temps surchargé, n’ont bien souvent ni le temps ni les ressources nécessaires pour explorer ces travaux de manière autonome. Cela souligne la nécessité de renforcer les collaborations entre les personnes chercheuses et les personnes praticiennes, notamment à travers des formations coconstruites ou des communautés de pratique (CoP).
Pour répondre à ces enjeux, un numéro thématique récent de la revue Didactique ayant pour titre La recherche en didactique pour soutenir le développement professionnel enseignant (Araújo-Oliveira et al., 2024) explore la question suivante : comment la recherche en didactique peut-elle soutenir le développement professionnel continu des enseignantes et des enseignants ? Sans prétendre apporter des réponses définitives à cette question, les différents articles de ce dossier mettent en lumière des pistes prometteuses.
Les travaux présentés dans ce dossier thématique démontrent que la didactique, loin d’être une discipline scientifique abstraite, constitue un outil concret et puissant au service du corps enseignant. Constituée de huit articles rigoureusement évalués par des pairs, cette publication de grande qualité offre un panorama riche des contributions de la recherche en didactique au développement professionnel continu des enseignantes et des enseignants.
Les divers articles montrent comment la didactique aide les personnes enseignantes à mieux comprendre et enseigner les contenus, tout en adaptant leurs pratiques à la diversité des élèves et à leurs besoins. À titre d’exemple, une étude menée au Québec et une autre en Belgique explorent respectivement l’impact des croyances et des SEA en classe de mathématiques sur la formation initiale des futures enseignantes et futurs enseignants. Une autre recherche québécoise souligne l’importance de la contextualisation dans l’enseignement des sciences, tandis qu’une analyse, centrée sur l’enseignement du français au secondaire, examine comment le personnel enseignant peut mieux jouer son rôle si fondamental de médiateur des apprentissages. D’autres contributions élargissent la réflexion en explorant les dynamiques interdisciplinaires et les contextes internationaux d’enseignement et d’apprentissage de différentes disciplines scolaires. Une recherche collaborative entre le Québec et la France met en lumière les défis de l’éducation à l’environnement et au développement durable, tandis que des travaux belges et brésiliens abordent respectivement les représentations sociales lors des visites scolaires et le rôle des centres de soutien pédagogique dans la formation universitaire.
Conclusion
Ce dossier constitue ainsi une ressource précieuse pour allier recherche scientifique et pratiques de terrain tout en soutenant une formation continue ancrée dans la réalité des écoles. En s’appuyant sur les travaux présentés, les enseignantes et les enseignants peuvent développer des approches pédagogiques plus inclusives et pertinentes, renforcer leur expertise disciplinaire et valoriser la diversité culturelle et les besoins spécifiques des élèves.
Soutenir le développement professionnel continu des personnes enseignantes d’ici et d’ailleurs, c’est investir dans l’avenir de l’éducation. Par la recherche en didactique, les enseignantes et enseignants disposent d’un levier puissant pour enrichir leurs pratiques et accompagner les élèves de manière encore plus efficiente. Ce travail, qui combine réflexion théorique et applications pratiques, contribue non seulement à l’amélioration des apprentissages des élèves, mais aussi à la valorisation d’un métier essentiel pour notre société, celui d’enseignante et d’enseignant dans divers contextes d’exercice. En plaçant la didactique au cœur de leur réflexion, les systèmes éducatifs peuvent relever les défis actuels et offrir au milieu de l’enseignement les outils nécessaires pour transformer durablement les pratiques et favoriser leur développement professionnel continu.
Références
Araújo-Oliveira, A., Therriault, G., Charland, P. et Vivegnis, I. (2024). La recherche en didactique pour soutenir le développement professionnel enseignant. Didactique, 5(3), 4-13. https://doi.org/10.37571/2024.03
Develay, M. (1995). Le sens d’une réflexion épistémologique. Dans M. Develay (dir.), Savoirs scolaires et didactiques des disciplines: Une encyclopédie pour aujourd’hui (p. 17-31). ESF.
Lenoir, Y. (2020). Didactique : une approche sociohistorique du concept. Didactique, 1(1), 1239. https://doi.org/10.37571/2020.0102
Marcel, J.-F., Tardif, M. et Piot, T. (dir.) (2022). Trente ans de politiques de professionnalisation des enseignants, regards internationaux. Presses universitaires du Midi.
Mukamurera, J. (2014). Le développement professionnel et la persévérance en enseignement : Éclairage théorique et état des lieux. Dans L. Portelance, S. Martineau et J. Mukamurera (dir.), Développement et persévérance professionnels dans l’enseignement : Oui, mais comment? (p. 9-33). Presses de l’Université du Québec.
Reuter, Y. (2010). Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. De Boeck.
-
Courant d’idées permet à la communauté scientifique de l’UQTR de s’exprimer sur différents sujets et enjeux à travers une série d’articles vulgarisés pour le grand public. Consultez notre guide de rédaction.
Ouvert aux chercheurs, étudiants de cycles supérieurs et chargés de cours.