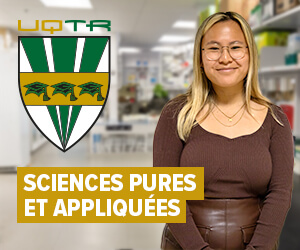Depuis 2021, de plus en plus de Trifluviens sont victimes d’inondations, ce qui pousse la Ville de Trois-Rivières à investir plus de 40 millions de dollars d’ici 2030 afin de régler cette problématique. Ce problème, nous l’avons nous-mêmes causé, mais heureusement, sa solution sillonne notre territoire sans que nous y en portions attention. Transformés en belles tranchées droites dans nos champs et quasi invisibles dans nos villes, les petits cours d’eau de têtes sont des écosystèmes riches, mais pour le moins sous-estimés quant aux services écosystémiques qu’ils peuvent rendre. En effet, protéger leur intégrité pourrait nous faire économiser beaucoup d’argent à l’avenir tout en améliorant notre qualité de vie et celle de notre environnement.
Cet article – Courant d’idées – est rédigé par Louis-Philippe Beauchamp, étudiant à la maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Louis-Philippe Beauchamp, étudiant à la maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) de l’UQTR.
Ces cours d’eau de tête, ce sont nos gouttières à l’échelle du territoire. Situés en amont, ils sont les premiers à récolter l’eau ruisselante des averses et de la fonte des neiges pour ensuite converger en une rivière qui se déversera pour alimenter notre fleuve Saint-Laurent. C’est un labyrinthe pouvant représenter jusqu’à 80 % du réseau hydrique d’une rivière. C’est donc dire que les rivières comme la Millette ou même la Saint-Maurice sont d’abord et avant tout des rigoles et des ruisseaux. En ville, leurs chemins sinueux sont dénaturés par des fossés bien droits, enterrés dans des canalisations bien sombres ou sont ensevelis sous nos aménagements. On peut penser que ces structures sont nécessaires au bon fonctionnement de notre environnement urbain, mais elles ne sont pas sans conséquences. Et si l’on vous disait que c’est à la source de nombreux problèmes comme les inondations, seriez-vous prêts à modifier le paysage de vos terrains pour redonner à ces cours d’eau leur autonomie ?
Des écosystèmes qui nous rendent service
Les cours d’eau de têtes sont des écosystèmes riches qui puisent une partie de leur importance dans les bénéfices qu’ils apportent à la population ; ils nous rendent des services écosystémiques. Le passage obligé de l’eau dans ce labyrinthe ralentit sa course, lui permettant de se déposer et de se laisser absorber par le sol. Il se crée alors un équilibre entre l’eau qui entre dans le réseau hydrique et la quantité qui est rejetée dans le fleuve, évitant ainsi que la rivière déborde de son lit. Tandis que tous les chemins mènent à Rome, tous ne s’y rendent pas à la même vitesse… quand ils s’y rendent.
Toutefois, en dénaturant notre territoire, ces petits cours d’eau peinent à nous rendre ce service. Nos pratiques d’urbanisme impliquant fossés, canalisations, pelletées de terre et béton simplifient considérablement ce labyrinthe hydrique. L’eau qui se heurte à nos surfaces imperméables ruisselle plus rapidement vers les cours d’eau restants et rejoint de manière plus linéaire et directe la rivière. Lors des grandes averses, la rivière peine à évacuer l’eau et c’est ainsi que nos quartiers, nos rues et nos sous-sols se retrouvent inondés.
Restaurer et protéger : notre monnaie d’échange
Pour que les rivières annuellement débordantes puissent nous donner un répit, il est impératif qu’elles conservent ou qu’elles retrouvent un réseau de cours d’eau de tête complexe et naturel.
Complexe pour que l’eau puisse s’accumuler à plusieurs endroits répartis sur l’ensemble du bassin versant. Pour qu’elle puisse se perdre avant d’atteindre la rivière. Pour qu’elle puisse patienter dans une plaine inondable, lieu où elle peut ralentir, sortir de son lit et créer un bassin éphémère jusqu’à son évacuation.
Naturel pour que dans sa course, l’eau se heurte à des troncs, des branches et autres débris ligneux qui ralentissent la vitesse de son courant. Pour que sa course vers la rivière ne soit pas un sprint, mais plutôt un parcours à obstacle. Pour qu’à son passage, les racines des arbres et des plantes ripariennes l’empêchent d’emporter avec elle le sol dans lequel elles reposent. Pour que les averses qui se heurtent aux surfaces imperméables puissent être filtrées par le sol et les racines avant d’atteindre la rivière au lieu de suivre les bords de rues et les canalisations emportant sels de route, contaminants et déchets jusqu’à elle.
Recréer un réseau de cours d’eau complexe et naturel, c’est déterrer ceux qui ont été ensevelis, même s’ils traversent nos terrains. C’est réduire les surfaces imperméables chez soi et dans les lieux publics comme nos entrées de garage, nos stationnements inutilisés et nos rues trop larges. C’est de diriger l’eau qui ruisselle sur les surfaces imperméables sur nos terrains, dans nos parcs ou les terrains vagues avant qu’elle ne rejoigne la rivière. Enfin, c’est de laisser de la place à ces cours d’eau et leurs rivières pour respirer. Pour qu’ils puissent gonfler sans s’excuser lors de la fonte des neiges puis rapetisser en période sèche.
Un service qui en vaut plus
Réguler les épisodes d’inondations en redonnant de l’espace et de la liberté aux cours d’eau de tête, c’est aussi améliorer le rendement d’une multitude d’autres services écosystémiques que ces milieux riches peuvent nous rendre. De la régulation de la température à la purification de l’eau, en passant par un maintien de la biodiversité, ces cours d’eau sont des alliés non négligeables. Dans un contexte de changements climatiques, leur résilience influencera directement la nôtre face aux hausses de températures et à la raréfaction des ressources comme l’eau. Enfin, ces écosystèmes apportent une valeur esthétique et culturelle à nos milieux de vie en diversifiant le paysage visuel et auditif de notre environnement. Notre bien-être a alors tout à gagner de restaurer les cours d’eau de tête anthropisés et de protéger l’intégrité de ceux qui l’ont encore aujourd’hui.
Références
Dixon, S. J., Sear, D. A., Odoni, N. A., Sykes, T., & Lane, S. N. (2016). The effects of river restoration on catchment scale flood risk and flood hydrology. Earth Surface Processes and Landforms, 41(7), 997-1008. https://doi.org/10.1002/esp.3919
Ferreira, V., Albariño, R., Larrañaga, A., LeRoy, C. J., Masese, F. O., & Moretti, M. S. (2023). Ecosystem services provided by small streams : An overview. Hydrobiologia, 850(12), 2501-2535. https://doi.org/10.1007/s10750-022-05095-1
ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (2025, mars 12). Des chantiers pour réduire les inondations dès cette année à Trois-Rivières. Radio-Canada; Radio-Canada.ca. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2147336/gestion-eau-trois-rivieres-inondation-sienne
Richardson, J. S. (2020). Headwater Streams. In M. I. Goldstein & D. A. DellaSala (Éds.), Encyclopedia of the World’s Biomes (p. 371-378). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11957-8
Courant d’idées permet à la communauté scientifique de l’UQTR de s’exprimer sur différents sujets et enjeux à travers une série d’articles vulgarisés pour le grand public. Consultez notre guide de rédaction.
Ouvert aux chercheurs, étudiants de cycles supérieurs et chargés de cours.