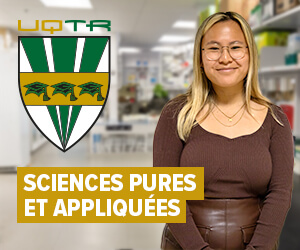En matière de stupéfiants, le marché illicite est en constante évolution. Lorsque de nouvelles drogues font leur apparition, leur usage tend à se répandre rapidement au sein de la population. Chez les consommateurs, celles-ci peuvent avoir des effets dévastateurs, comme en témoigne la crise des opioïdes. Si les gouvernements déploient des efforts considérables pour lutter contre ce fléau, le combat ne se déroule pas toujours à armes égales. Surtout lorsque l’adversaire n’est pas connu.
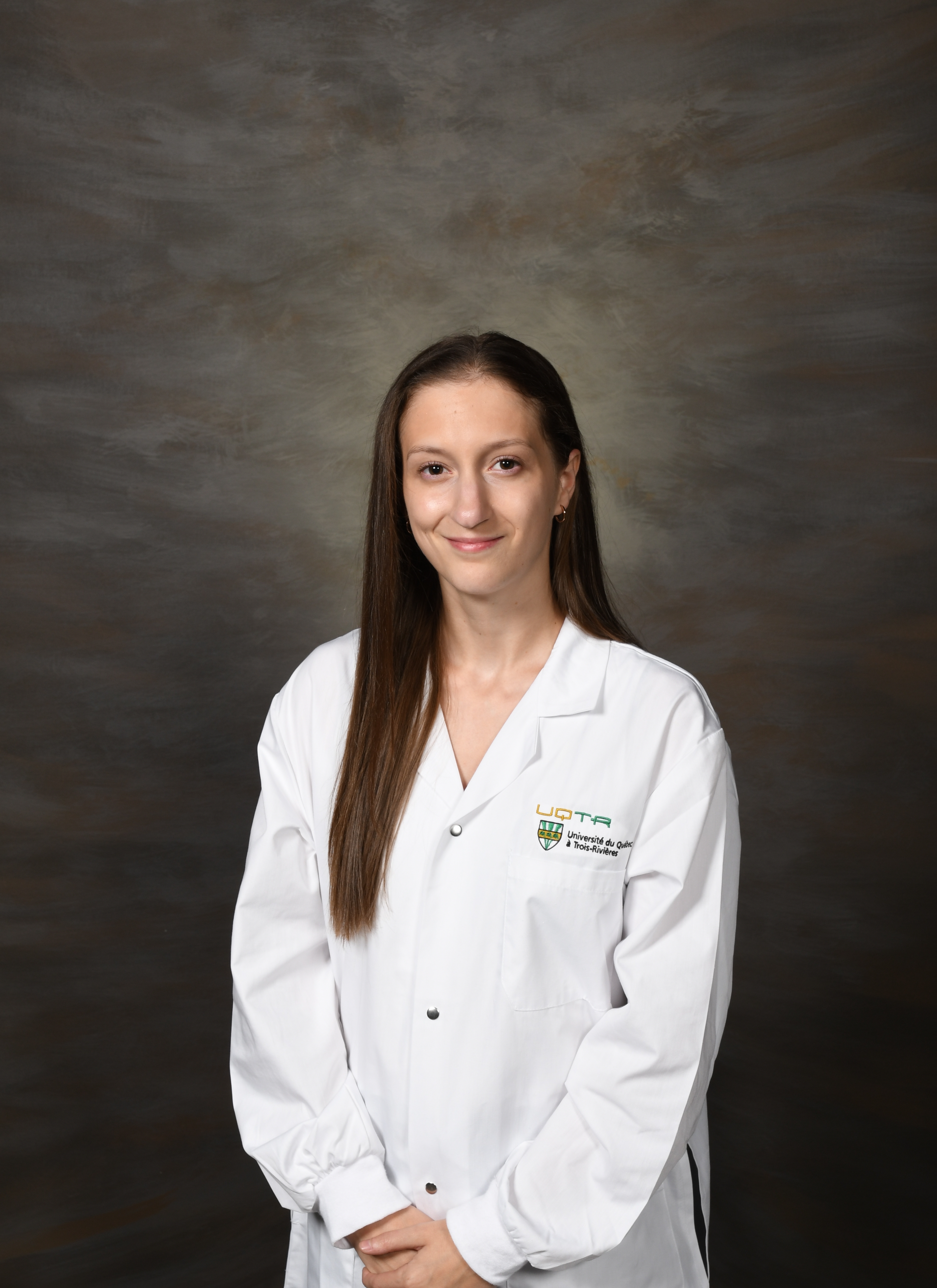
Gabrielle Matteau, étudiante à la maîtrise en chimie de l’UQTR.
Conformément à son rôle, la santé publique collecte de précieuses informations sur les substances psychoactives. Ces renseignements permettent aux autorités d’intervenir de manière rapide et adéquate quand la situation l’exige. Or, lorsque de nouvelles drogues font leur apparition dans le paysage social, le Centre de toxicologie du Québec (CTQ) se retrouve confronté à un manque de connaissances.
« En ce moment, la méthode utilisée permet d’analyser plus de 300 drogues, médicaments et métabolites différents. L’enjeu, c’est que les habitudes de consommation changent continuellement. Par exemple, si le Centre antipoison prélève un échantillon sur un patient en overdose, et que l’intoxication a été causée par un nouveau composé, le CTQ va avoir du mal à l’analyser. Quand la substance n’est pas répertoriée dans les bases de données, c’est très difficile d’obtenir des résultats probants. Et en l’absence de données, la drogue continue de faire des ravages », indique Gabrielle Matteau, qui poursuit sa maîtrise en chimie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Si une période d’apprentissage est habituellement nécessaire pour permettre à la santé publique de s’adapter, les travaux de l’étudiante pourraient cependant changer la donne. En vertu d’un partenariat avec le CTQ, Gabrielle a reçu le mandat de développer des outils qui pourraient permettre d’identifier de nouvelles drogues de synthèse.
« Il existe plusieurs méthodes pour analyser les xénobiotiques. Ce mot désigne l’ensemble des substances qui ne sont pas produites naturellement par le corps, ou qui ne font pas partie d’une alimentation normale. On parle donc des drogues et des médicaments, mais aussi des métaux, par exemple. La principale méthode utilisée par le CTQ est l’analyse ciblée, qui consiste à demander aux appareils si l’échantillon correspond à l’un des composés répertoriés. Bien que relativement rapide, cette méthode n’est efficace que pour les substances qui sont déjà connues », explique-t-elle.
« Si l’on ne trouve pas ce que c’est, on peut se tourner vers l’analyse non ciblée. Cette méthode permet de décortiquer absolument tout ce qui se trouve dans l’échantillon. Évidemment, il faut ensuite passer les résultats en revue pour distinguer le composé psychoactif du reste. Ça demande beaucoup de temps de traitement, mais ça permet de recueillir de l’information sur ce qu’on ne connaît pas encore », ajoute l’étudiante.
La réponse du corps
Si cette avenue offre de plus grandes possibilités, il reste quand même un débroussaillage important à faire. Loin d’être embêtée par cette somme de travail, Gabrielle y voit plutôt un défi qu’elle peut surmonter. En parlant des solutions qu’elle souhaite explorer, son regard s’anime promptement.
« Pour faciliter l’identification des drogues inconnues, mon projet de recherche propose de développer une méthode de prédiction des métabolites. Quand on consomme une drogue, notre organisme va modifier sa structure moléculaire, afin qu’elle soit plus facile à excréter. Autrement dit, pour sortir la drogue de notre système, le corps va la changer en métabolites. Ce phénomène est excessivement important, parce que souvent, les échantillons biologiques qui parviennent au CTQ (un prélèvement d’urine, par exemple) ne contiennent presque plus la substance de base ; il reste majoritairement des métabolites. En cernant ces derniers, on peut donc établir ce que l’on devrait voir lorsqu’une personne a consommé la drogue en question », précise-t-elle.
Afin de garder le rythme par rapport à l’évolution du marché illicite, Gabrielle propose de mettre en place une méthode pour générer des métabolites in vitro. L’idée est, somme toute, assez simple : en laboratoire, l’équipe du CTQ pourrait « nourrir » des cellules de foie avec la drogue inconnue, afin de produire artificiellement des métabolites.
« Le foie joue un grand rôle dans le processus métabolique, c’est pour ça que je préconise ce type de cellule. Plus précisément, ce sont les hépatocytes qui exercent les fonctions qui nous intéressent. On peut les utiliser comme tels, mais ils coûtent assez cher, et leur durée de vie est plutôt limitée. Heureusement, on peut aussi se tourner vers les extraits d’hépatocytes. Une autre alternative serait d’utiliser ce qu’on appelle les lignées cellulaires. Celles-ci offrent un rendement semblable à celui des hépatocytes, mais comme elles sont reproductibles à l’infini, leur coût est considérablement plus bas. Dans tous les cas, cette méthode permettrait de prédire le métabolisme de la drogue, afin de la reconnaître plus facilement dans l’organisme des utilisateurs », souligne l’étudiante.
Ultimement, le projet de Gabrielle permettrait au CTQ d’obtenir de l’information sur n’importe quelle drogue à partir d’un simple échantillon. Cette avancée comblerait au moins en partie le manque de connaissances qui afflige actuellement la santé publique.
Des expertises… et une fascination
Considérant l’importance de son projet de recherche, l’étudiante fait l’objet d’une double supervision. Si d’un côté elle travaille sous la tutelle de Nicolas Caron, chercheur au CTQ, c’est le professeur Cyril Muehlethaler, du Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR, qui dirige son mémoire.
« Leurs expertises sont vraiment complémentaires. En général, les gens du CTQ sont des chimistes ou des biochimistes, alors que Cyril, lui, se spécialise notamment dans le traitement des données. C’est très pratique, parce que l’analyse non ciblée implique une quantité astronomique de données à traiter. Il apporte donc une dimension d’optimisation à mon projet », remarque Gabrielle.
La principale intéressée se réjouit également à l’idée d’approfondir ses connaissances en analyse de substances psychoactives. En effet, elle souhaitait déjà développer cette expertise alors qu’elle étudiait au baccalauréat en chimie (profil criminalistique). Donc, lorsqu’on lui a proposé son projet actuel, qui impliquait l’opportunité tant attendue, elle n’a pas hésité longtemps.
« C’est un professeur qui m’est arrivé avec ça, en me disant qu’il y avait un besoin là-bas. Comme le projet tournait autour de la toxicologie, il se doutait que ça m’intéresserait. Et effectivement, son offre ne pouvait pas mieux tomber. En plus, le CTQ m’accordait une bourse pour poursuivre mes travaux, alors je ne pouvais pas refuser », se souvient Gabrielle.
Plus encore, le mandat confié à l’étudiante lui permet de clore une boucle qu’elle avait entamée il y a longtemps.
« Mon intérêt pour la chimie criminalistique a toujours été là. J’en ai entendu parler pour la première fois quand j’étais au secondaire, et même si j’ai exploré d’autres avenues au fil de mon parcours, c’est toujours à ça que je suis revenue. D’une part, l’aspect chimique m’intéressait beaucoup, parce que la structure moléculaire des drogues est directement reliée à leurs effets sur le corps et sur le cerveau. D’autre part, je trouvais qu’il y avait quelque chose de fascinant dans le phénomène social entourant les drogues de synthèse. La consommation, les dommages que ça crée, la recherche de substances de plus en plus fortes… On a tendance à l’oublier, mais le milieu de la criminalistique existe parce qu’il y a des gens au centre de tout ça », conclut-elle.