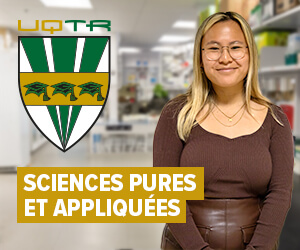Une quinzaine d’étudiants du baccalauréat en géographie environnementale ont eu la chance de visiter l’Abitibi en octobre 2024, dans le cadre du cours « Géographie du déchet » donné par la professeure Cynthia Morinville.

Anne-Laure Morin, étudiante à la maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) de l’UQTR.
Cet article – Courant d’idées – est rédigé par Anne-Laure Morin, étudiante à la maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Le but de cette visite était d’explorer la gestion des déchets miniers tout en découvrant les méthodologies de la recherche en sciences sociales. Auparavant, aucun des participants n’avait mis les pieds dans cette région du Québec. Après un départ Trois-Rivières, nous avons pris la route en direction de Val-d’Or, notre camp de base pour les trois jours à venir. En tant qu’auxiliaire de cours et étudiante à la maîtrise en sciences de l’environnement, j’ai eu la chance d’accompagner ce groupe.
Le premier jour, Sébastien Brodeur-Girard, professeur à l’École d’études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), nous a guidés dans l’ancien village minier de Bourlamaque. Ce site patrimonial historique est composé de maisons unifamiliales en bois rond. Fondé en 1934, il a été construit pour loger les familles des travailleurs de la mine Lamaque et témoigne d’une époque marquée par le boom minier.

Le site patrimonial historique de Bourlamaque, un ancien village minier à Val-d’Or. (Photo: Jérémie Rioux)
La Fonderie Horne et le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda
La deuxième journée a commencé par une visite guidée de la Fonderie Horne. Avant de nous rendre sur place, nous avions lu sur l’histoire de la Fonderie et sur les enjeux de santé publique qui y sont associés. En effet, des polluants issus des différents procédés métallurgiques sont relâchés dans la ville de Rouyn-Noranda, comme le plomb, le cadmium et l’arsenic. La Fonderie Horne est l’un des rares endroits en Amérique du Nord où l’on recycle des déchets électroniques, ce qui constitue l’un des principaux attraits de notre visite. De loin, deux grandes cheminées se dessinent dans le paysage, signalant la présence de l’usine. Équipés de vêtements de protection, nous remarquons les diverses piles de concentrés de minerai prêts à être fondus et explorons les installations utilisées pour produire des anodes de cuivre.

Le groupe en visite à la Fonderie Horne. (Photo: Glencore)
Le dîner se déroule ensuite avec un autre invité, Hugo Asselin, professeur à l’UQAT et directeur de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Il nous parle de sa lettre ouverte publiée dans La Presse intitulée « Rouyn-Noranda n’est pas dépendante de la Fonderie Horne ». Celle-ci a fait l’objet de vives critiques et M. Asselin y argumente que la ville, ses habitants et son développement économique ne sont pas dépendants de l’usine, une opinion qui contraste avec la visite du matin. Nous avons hâte d’en apprendre davantage sur l’impact social, économique et environnemental d’une telle industrie en plein cœur de la ville.
L’après-midi se poursuit avec une discussion sur les enjeux de santé environnementale animée par Daniel Proulx, directeur du nouvel Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l’environnement. Stéphane Bessette et Élise Ariane Cabirol de la direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue viennent ensuite nous entretenir sur les différents projets de biosurveillance auxquels ils ont participé, notamment sur l’exposition à l’arsenic des résidents habitant à proximité de la Fonderie – un projet qui procède par l’échantillonnage d’ongles pour mesurer la bioaccumulation de ce contaminant ! Enfin, l’historien Benoît Beaudry-Gourd nous guide pour un tour du quartier Notre-Dame, situé juste à côté de la Fonderie Horne. Certains habitants de ce quartier sont destinés à être relocalisés, car l’émission d’arsenic y est cinq fois plus élevée que la norme québécoise en vigueur. M. Beaudry-Gourd a d’ailleurs passé la majeure partie de sa vie à cet endroit, et nous raconte quelques-uns de ses précieux souvenirs dans le quartier.

Une vue sur le quartier Notre-Dame qui sera détruit et dont les habitants seront relocalisés en lien avec la mauvaise qualité de l’air. (Photo: Philippe Aubichon)
Visite de sites miniers et d’un village abandonné
Lors de la troisième journée, nous nous sommes rendus sur le territoire de Eeyou-Istchee Baie-James, accompagnés de trois intervenants. Notre première guide, Valérie Plante-Lévesque, est une ancienne résidente de Joutel. Elle nous fait découvrir son village minier d’enfance, aujourd’hui abandonné, et qui a vu toutes ses maisons être relocalisées à la fin des années 1990 en raison de la fermeture des sites miniers à proximité.

Rue et terrain asphalté de l’ancien village de Joutel. (Photo: Jérémie Rioux)
Finalement, accompagnés de Rodrigue Turgeon, un avocat et citoyen engagé travaillant pour Mining Watch Canada, un organisme de surveillance sur l’industrie minière, nous avons visité deux sites miniers de la région. Ces mines sont aujourd’hui inactives, mais non sans possible contamination. Forts de notre formation préalable en santé et sécurité, nous avons mis nos protections personnelles avec entrain. Nous avons pris deux échantillons d’eau, un à l’aval et un à l’amont des résidus miniers, ainsi que deux échantillons de sol terrain. Ils seront analysés plus tard par des étudiants volontaires.

Cours d’eau sur un site minier à Eeyou Istchee Baie-James. (Photo: Ève Gervais)

Échantillonnage de l’eau d’un site minier abandonné pour évaluer la présence de drainage acide. (Photo: Anne-Laure Morin)

L’équipement de protection personnelle est nécessaire pour échantillonner un site minier : veste orange, gants, masque, lunettes de protection, couvre-chaussures. (Photo: Philippe Aubichon)
Sur le chemin du retour
En chemin vers la maison, nous avons fait un arrêt dans la ville de Malartic. Cette ville a été déplacée à deux reprises pour agrandir une mine à ciel ouvert sur son territoire. Celle-ci nous laisse sans voix en raison de l’ampleur impressionnante du site.

Le site minier de Malartic, situé en plein cœur de la ville. (Photo: Philippe Aubichon)
De retour dans les laboratoires du centre de recherche RIVE à l’UQTR, nous analyserons les prélèvements d’eau et de sol avec des volontaires du cours, offrant ainsi à quelques chanceux l’opportunité de s’initier à l’étude de sites contaminés. Les étudiants devront aussi remettre à leur professeure leurs notes de terrain, ainsi qu’une note ethnographique, dans laquelle ils décriront leurs observations au cœur de cette région, où peuvent se confronter des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des mines.
-
Courant d’idées permet à la communauté scientifique de l’UQTR de s’exprimer sur différents sujets et enjeux à travers une série d’articles vulgarisés pour le grand public. Consultez notre guide de rédaction.
Ouvert aux chercheurs, étudiants de cycles supérieurs et chargés de cours.